
J’ai toujours ressenti l’expression de soi dans l’art comme un non sens.
L’important n’est pas l’expression mais la transmission. La volonté, l’ambition ultime n’est pas de monter ce que nous sommes ou de l’exprimer, encore moins de démontrer quoi que ce soit - mais d’écrire physiquement dans le cœur du lecteur, du spectateur, de l’autre, en face, dans sa personnalité même, dans son affect, son cerveau, son âme, au plus profond de ses propres reins… une émotion, une pensée, qui peut-être le changera, un peu, qui, peut-être, participera à sa vie… et l’aidera à vivre un peu plus, un peu plus loin. Toutes les techniques, toute la cuisine interne, ce long travail patient et acharné, répond à disparaître. Pour donner à exister un peu plus.
L’important n’est pas ce qui est écrit, mais ce qui ne l’est pas. En fait, tout ce qui existe concrètement vise à cela, au-delà des mots, des images, d'un médium vers l’immatériel.
Bien sur, le principal risque est de devenir abscond, abstrait, absurde. Un risque, certes – mais tout est question d’équilibre, de talent. Et cela n’enlève pas la vérité, au contraire, elle ajoute des contraintes, un stade supérieur à l’expression, qui vise à la transmission.
Jean Paulhan disait à Pauline Réage que la fin d’Histoire d’O ne lui convenait pas, que l'écrire ne servait à rien. En fait, la mort de O allait de soi, existait déjà dans l’esprit du lecteur – dés lors, pourquoi l’écrire ? Peut-être est-ce cela la qualité suprême : amener à... et puis laisser faire l'être...
C’est particulièrement flagrant dans les nouvelles d’Hemingway ou de Carver : est écrit ce moment particulièrement où tout bascule, le point d’inclination – après, le reste, l’avant, l’après… quel importance, au fond ?
J’ai revu Chinatown de Polanski cette semaine… Plus que l’histoire, la technique, la perfection, tout le film nous emmène à cette simple phrase : 'Laisse, Jack, c'est Chinatown'. Et que nous aussi nous devons vivre avec cela.
Voilà, le cycle intime s'est terminé aujourd'hui- et c'est marrant que cela tombre avec une fin d'année, qui elle-même se clos avec une fin de semaine... Un autre s'ouvre - mais vers où ?
vendredi 29 décembre 2006
jeudi 28 décembre 2006
Vive Michel Muller

http://www.leblogtvnews.com/article-5045373.html
A lire absolument - c'est réjouissant, jouissif... et tellement désespérant de la télévision française... enfin d'une partie...
Publié par Michel le jeudi, décembre 28, 2006 0 commentaires
Un souffle plus loin

"Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles ; et l'harmonie la plus douce est le son de voix de celle que l'on aime."
La Bruyère, Les caractères… des Femmes
L'art est votre visage, mon aimée.
Et ma douleur, aussi.
Mon ami,
Demain je mourrai de mes intrigues et sans regret, comme une femme vous ayant aimé. Et le sort qui m’attend m’indiffère, c’est à une autre qu’ils couperont la tête. Mon âme est morte, il y a bien longtemps, en vous.
Ici, les murs noient ma lucidité. Comme mon orgueil face à votre amour, le temps approche l’éternité. Ma cellule est un dôme aux murs qui suintent, au plafond si haut que je ne peux m’y pendre, aux pavés si froids que mes pieds nus se relèvent, effleurent, n’osent toucher la fine pellicule d’eau qui recouvre le sol. C’est une vision étrange que mon amour pour vous, mon ami, une image que la nuit fatigue, tend à l’extrême, et qui donne une acuité particulière aux choses premières, si proche de la folie, si lucide.
Mes mains sont écarlates, mes vertèbres se cristallisent au froid, à mes souvenirs. Mes sentiments se décuplent plus que je ne saurais l’imaginer tout à fait, et je pleurs comme seule expression de mes sentiments. Ma peau toute entière s’égraine du peu de lumière et de la largeur du temps… Oh ! mon amour, les mots se dépouillent, me demandent tant d’efforts, m’imposent l’honnêteté.
Je respire, lâche. Et j’attends.
***
Je perds la vie, et vous l’amour. Mais la sentence exécutée nous rend libre de nos chimères, de nos mensonges et de mes détresses. Ne me tenez plus rigueur de la liberté qui m’est ainsi offerte.
A trop me protéger, j’avais oublié jusqu’à votre amour, jusqu’à votre premier amour... jusqu’à vos mots. Je fus si pathétique que je vous abandonnai à une autre. Souvent mes lèvres frémirent, souvent je me suis retenue de vous le dire, dans une étrange pudeur, dans mon incrédulité aussi à éprouver un sentiment, à vous aimer. Ce paradoxe est étrange : vous m’offriez un présent que je ne pouvais accepter, et je meurs de n’avoir pas eu ce courage.
Sans doute son apparente fragilité était sa force, et mon impatience à la faire souffrir, ma propre faiblesse. Ou bien, était-ce de vous aimer plus que je ne le pouvais. Je m’étais pourtant résignée à vous perdre.
Nous nous sommes quittés bien lamentablement.
***
Nous avions retrouvé ensemble notre liberté d’infidélité. Je n’imaginais aucune rivale, non pas à mon corps, mais à mon cœur, aux sentiments échangés, à l’émotion qui vous soufflait alors à mon oreille les phrases amoureuses.
Nous ne nous parlions plus, nos corps étaient épuisés. A trop vouloir jouir, nous avons perdu ensemble cet instant précieux, notre rupture. A l’image de cet échec, votre amour se détruisit.
***
Je me souviens… Je me souviens de ce lit défait sans passion, de ces restes éparpillés, presque pliés, sombres, timides. Nos vêtements étaient timides. Vous observiez mon corps une dernière fois. Je m’habillais pour vous, je me coiffais, déjà sans vous.
Sans un mot, un seul baiser sur mes cheveux, vous êtes partis.
Je m’arrêtais – je me suis arrêtée. Ma douleur fut si douce, lointaine, si ample qu’elle me drapa lentement de sa lumière. Et j’ai vieilli.
Loin de vous, j’ai vieilli.
Moi aussi, j’ai aimé, puissamment, fébrile...
Oui, je vous aimais, avec ardeur et sang.
***
Mais qu’est-ce que l’intimité ? Partager les vagues ? Partager notre cœur ou notre esprit ? Rien de tout cela en vérité, je vous l’écris, c’est se mêler. Plus que s’unir, c’est se perdre, se dissoudre, dans le temps de l’autre - se retrouver, se réveiller plus loin, souvent en deçà de soi-même.
Aimer, est-ce renoncer à exister, presque se trahir ?
Aimer, c’est se décevoir dans le temps. L’ennui, le quotidien où nous espérons échapper aux modalités de l’existence, à notre propre banalité. Et sans plus de conviction, nous vieillissons. Notre amour nous devance, il vieillit avant nos rides, c’est lui-même qui nous exécute.
Rire et mourir : la vie donne des promesses inaccessibles que nous feignons de croire. L’amour : effondrement, chute de la jouissance. Aimer n’est rien sans la jouissance – et pourtant, le plaisir n’est pas tout. Etrange dissonance où, moi aussi, j’ai cru à l’éternité. Qu’ai-je donc perdu à ne plus croire, à perdre cette foi ?
En vous, ai-je perdu les palpitations de l’amour ? Vous ai-je jamais aimé par négligence, par habitude, parce que nous nous nous aimions, parce que nous nous sommes aimés ? Et que m’importe le reste si nos souvenirs perdurent. Ils ne sont peut-être pas si loin, encore intouchables. Existe-t-il un âge où il n’est plus permis d’aimer, ni même d’espérer se retrouver, au-delà des rides ? Aimer, jouir encore une fois, au-delà , dans la tendresse, est-ce illusoire ? Mais la jouissance n’est rien de plus que la séduction : est-ce cela… n’est-ce que cela ?
La jouissance dans l’amour n’est rien qu’un refuge puéril sans le bonheur. Je me suis mentie, parce que j’aimais, plus loin que le plaisir ou la séduction, je vous aimais. Sans rêve, l’amour n’est rien. Il n’est plus lucide, il n’espère plus, ne jouit plus. Sans rêve, l’amour devient distrait. Mais j’espère toujours, et c’est là ma tristesse, malgré demain, malgré votre abandon.
Je me suis cachée à vos yeux, amoureuse, j’ai renoncé à exister, j’ai déçu vos propres fragilités et vous vous êtes fié à mes rires. Mais, derrière nos habitudes, nous dissimulons notre vie, nous parachevons le regard des autres dans une pudique lâcheté.
***
Et ce fut le soleil, le charme, la beauté, l’indifférence au mariage, comme le cristal. Si belle, que je voulais la protéger, si pure, propre à la rupture, déchirée, une étincelle d’eau, inconsciente d’elle-même. Mais que pouvais-je répandre ? Vous-même ? L’éducation du plaisir ? Elle transfigura mon regard de son émotion. Elle n’aimait pas plus les hommes que son propre sexe – elle attendait, vivait votre amour comme je ne pourrais le vivre jamais. Et j’ai su que vous vous aimiez, que la liberté réclamée était vouée à l’enchaînement de son âme.
Oui, je le compris à la croisée de ses yeux, de vos yeux… de votre regard glissant sur son sourire…
La foule se répartissait en de petits groupes bruyants, hypocrites et hilares. La musique, le bal, distillaient une atmosphère irréelle, couvrant les banalités des conversations, je naviguais d’invités en invités, de compliments en attentions. Et je me suis approchée de vous, je vous observais, sans perdre les intonations de votre amour naissant.
Elle dormait si loin, dans le salon orange, éteint, lentement diffuse, ses cheveux éparpillés, échappés d’un chignon approximatif. Et vous osiez lui sourire. Elle semblait vous parler, dans un souffle, en de petits gémissements presque inaudibles. La lumière donnait à sa peau des reflets, et son visage, doucement régulier, harmonisait ses joues, son nez… sa bouche respirait en un doux souffle court… repliées, mordillées, ses lèvres se tendaient déjà vers vous.
Et vous l’avez couverte, de peur qu’elle n’ait froid - la première attention forge l’amour, n’est-ce pas ?
Elle dormait et vous osiez lui sourire, et elle vous répondait de sa beauté, simplement belle, je respire par elle. Il ne me sembla pas en cette nuit exister de plus belle intimité, celle qui rend heureux, celle qui vous exclue de la vie.
Elle se réveilla pourtant à vos gestes timides, amoureux et chastes, qui osèrent enfin la toucher. Sa main caressée, quels ont été vos mots pour la séduire ? Je les entends encore aujourd’hui me faire souffrir… Quelle chose me donna le vertige : les mots, le tutoiement soudain ? J’ai titubé, chancelé, au rythme de votre amour, j’ai chaviré à l’impudeur de vos premiers mots.
***
… Je voulais étreindre ma bouche sur vous, entière, pleine, et vous mentir d’amour, vous séduire… Mais je ne peux que vous couvrir de mes larmes et espérer que vous les éclatiez de votre rire… Je veux simplement caresser de mes doigts vos lèvres, et enfin aimer… aimer plus que le bonheur, le souffle plus que les mots…
Oui, je rêve au doux silence de votre présence, à la douce pensée de vous voir endormie dans mes bras, vous si belle, à mes côtés…
Oui, je rêve de notre intimité,
Intimité, je l’écris comme amour,
Intimité, si désirable, si belle, si profonde,
Tant espérée devant trop de lassitude…
Oui, je rêve de vous posséder,
Je rêve à votre voix qui se couche lascive dans mon oreille,
Qui frémit de votre caresse…
Votre voix, si sombre, si dense, si émue…
Et ma bouche hésite, se dénude, peu à peu…
Oui, je rêve de notre intimité,
Celle passé, celle futur, celle que je ne veux décrire
Celle où je vous aime, endormie…
Celle où nous nous aimons…
Donnez-moi votre nez,
Donnez-moi vos yeux,
Votre front,
L’essence de vos cheveux…
Donne-moi tes lèvres,
Donne-moi ton nez
Donne-moi tes yeux
Ton front
L’essence de tes cheveux
Donne-moi tes doigts
Ton âme ton être
Donne-moi toi
Donne-moi ton oreille
le lobe de ton oreille
Donne-moi ton bras
tes seins
les cieux de tes reins
Donne-moi ton nez
Donne-moi tes dents
Donne-moi tes cils
tes paupières tes pommettes
tes paumes ton île
Donne-moi tes jambes
ton ventre ton antre
Donne-moi tes rides
Ces rides quand tu ris
et la mèche
la mèche de ton sourire
Donne-moi tes doigts
ton âme ton être
Donne-moi toi.
Oh ! tes lèvres, tes doigts, ton âme, ton être, toi… le lobe de ton oreille, tes seins, tes jambes, ton visage, le grain de ta peau… et ton antre, ton rire, et les rides de ton rire… et la mèche de ton sourire…
Au mur de son silence, le bruit de la foule, vos yeux se sont fermés d’attendre. Mais elle vous répondit. Insensible à son vol, elle perça mon cœur de son sourire, caressa, naturel douloureux, votre visage.
Et moi, que puis-je vous dire ? Je vous aime. Bien avant votre amour, je t’aime… Certaine d’être à toi, un jour… Certaine t’entendre le souffle même de ton amour… Le bonheur simple d’exister dans tes yeux… de chérir tes yeux… Avant ma propre conscience, je t’aimais… avant même d’exister, je t’aimais… Nos cœurs sont destinés l’un à l’autre… à se nourrir de l’autre… à vivre et à chanter… Ce soir n’est que la révélation de notre amour.
Plus tard, seule, dans le noir de mes appartements, j’ai pleuré, suffoqué, sangloté, trébuché, saccagé.
***
Il fût un temps où j’existais pour vous, où mon rire ne charmait que vous. Seul, vous regardiez mon âme, et vos doigts se perdaient en moi... et autant que moi, ils y prenaient du plaisir, avant...
Je vous protégeais de mon corps, toute entière... L’intimité n’existait que pour nous, qu’en nous... Vous me caressiez durant l’amour, vos mains se répandaient sur ma peau, un plaisir en plus de étreintes... Je souffle encore ce bonheur, de cet amour pour vous, malgré moi, malgré tout cela. Mais j’ai vieilli et votre amour aussi... Aujourd’hui, je m’exécute plus que je ne jouis. Mon amour est devenu pudique, le vôtre s’est alourdi.
Nous ne nous regardions plus, tout simplement.
Pourtant, j’ai connu votre amour, le premier jour.
***
Il bruinait légèrement dans le soleil du petit matin et je marchais pour le plaisir dans les rues animées, parmi les enfants et les marchants ambulants, un ange, un colporteur de musique… Vous me suiviez, n’osiez vous approcher plus que du regard. Vos pas étaient hésitants et votre cœur tremblait si fort que j’ai connu ses pensées.
Elle ajuste son col à sa voix écharpée, et ses doigts, au passé. Son émotion n'est plus fixée sur elle-même, et sous ce porche, sous l'eau de septembre, elle se dénude encore en été sous mon regard, voyeur.
« Elle est belle, avec ses quelques rides de la quarantaine. Elle est belle, si pleine, si digne, fine, et maintenant libre… Sa tristesse apparente est noble, profonde à l'épure, affinée de toutes scories de romance.
« Elle a quitté ce porche comme on quitte un homme, et marche en pluie... Et je la suis, inconnu. Je l'imagine, façonne son histoire, sa douleur : délaissée, tristement délaissée d'un amant trop jeune ; je n'existe pas… pas encore.
« Elle me sourit, presque seule, hoche la tête et tourne ses cheveux... Belle, qu'elle est belle, belle à la méditation. Nue de cœur et de pensées fébriles, fidèles - elle semble prier. Mon épaule se languit déjà d'elle...
***
Le souvenir de vos premiers mots, de votre douce lettre, me donne encore le rire du bonheur. Ce message ne quitte plus ma poitrine, mes seins s’accroche encore au plaisir de vos mots. Je mourrais en vous lisant, demain. Votre voix s’unira à la mienne. Elle résonnera dans mon âme, jusqu’à la fin.
Mon incertitude d’aimer, Mon amour en devenir,
Chaque journée, vous passez et j’aime à vous regarder. Le paysage de votre visage me revient dans un souvenir d’un amour de gamin. Vos rêves et vos gestes, votre chevelure et votre corps imaginé sont ceux d’une personne passionnément aimée. Chaque instant vous enlève et vous rassemble.
Je vous aime.
***
Oh ! mon amour, je vous revoie, debout dans mon l’antichambre, droit comme un soldat, mûr comme un fruit, le bruit de votre cœur à porté de main. Je ris en demi-teinte, je tourne, tout autour de vous, vous êtes ma proie, vous, et l’amour…
- Quels mots doux allez-vous encore inventer ? Croyez-vous pouvoir me séduire, avec des mots, et vos seuls grands yeux, et votre cœur tendre ? Comme un amour paresseux ? Comme pour une femme trop jeune… ou déjà vieille ?
- Mes mots, ne sont que le reflet de mon désir, de vous. La séduction n’est rien si ce n’est que pour vous plaire, et non pour aimer. Vous connaissez mon cœur – et le cœur ne peut mentir, ni même trahir…
- Les mots ont été créés pour nous dissimuler aux regards d’autrui. Ils cachent nos pensés : êtes-vous si pur, si beau que votre cœur ne se distingue en rien de votre esprit, de votre chair ? N’êtes-vous pas comme nous tous, multiple ? M’aimez-vous comme un seul, unissant dans un accord parfait votre sang, votre cœur et vos pensées ?
- Dois-je défendre ma sincérité ?
- Oui, avec acharnement…
- Seriez-vous là à m’observer, si vous n’aviez pas reconnu en moi le son de la sincérité ?
- Vous raisonnez…
- Dois-je seulement toucher votre cœur et non votre esprit ? Séduire et aimer : est-ce incompatible ?
- Vous raisonnez…
- Les mots sont futiles, inutiles, s’ils ne se gravent pas dans votre cœur ; et je serai dès lors comme eux : une sonorité vide de sens, de sentiments...
- Vous raisonnez, encore…
- Dois-je me taire pour vous aimer ? Et si mon cœur crie malgré moi, que puis-je faire : renoncer ? ne plus vous désirer ?
- Toujours, vous raisonnez... Vous parlez trop.
- Que cachent mes mots… Que cachent-ils si ce n’est mon amour unique… ? En vous, je me perds – et je me révèle un seul… Que veulent-ils, Marquise ? … Que veulent-ils donc ?
- Mon corps.
Dans ce souffle, si prés de votre oreille, j’ai respiré jusqu’au grain de votre peau, embrassée, légèrement, anéantie dans vos bras, je me suis laissée faire, blottie au creux de votre épaule.
***
Calfeutrée dans vos bras, sereine, vous m’observiez, endormie, détaillant de vos mots ma beauté. J’étais belle dans vos bras, Matthieu… belle, bercée par vos yeux… belle, au doux murmure de votre voix…
Immobile dans son silence, une larme, elle s'endort, calme et souple dans l'amour, le long de ses rides d'enfant... et son rire, drapé par la lumière d'octobre... le désir immortel, la digne, la coquette… Oh ! Ta peau confond son grain à ma vie et les mots sont silence. Tes mains me fredonnent notre naissance... Nu, je suis habillé de toi... J'ai chaud à ma vie.
Je vois... je vois, dans l'incertitude de tes yeux, l'éblouissement, la vie inhumaine, la poésie... et encore perte, rupture, et toutes les cicatrices d'avant… Il y a des mots qui ne peuvent soutenir ton regard...
- A quoi pensez-vous ?
- Je ne pense pas. J'admire.
Naturellement, d’une simple histoire je suis tombée amoureuse, de vous.
***
Vous souvenez-vous de ce jour d’octobre où, parmi les arbres morts, à la supplique de vos yeux, je vous ai parlé, si peu.
- … Je parle, toujours je parle… mais vous ne dites rien, jamais… Et pourtant, j’ose croire à l’expression de votre amour… Votre regard, le battement même de vos paupières… vos lèvres... tout cela ne m’aime-t-il pas ? … Mais votre langue ne se délie jamais, pour moi… Vous parlez, mon amour… de nous – de moi surtout… Et de la vie : mais jamais un mot sur votre cœur… Mes silences sont plus éloquents que vos phrases, plus intimes… Mon amour, je ne suis pas dupe que l’écoute de mes silences est un prétexte pour vous à ne rien dire, jamais… Ou bien, est-ce une épreuve à mon amour, un piège ? … je vous aime… et l’écoute de votre cœur me manque… tellement… Je vous en prie, parlez-moi, un peu… parlez-moi… de vous, de nous… votre voix seule me manque, elle est devenue trop discrète, presque méconnue… C’est une prière… une supplique… un instant de bonheur devancé… demandé... Oh ! mon amour… j’aime vous regarder ; accordez-moi la parole, pour que je sois complet…
- Moi, j’aime vous écouter, prendre vos mots, les recueillir, les protéger… Comme vous vous nourrissez de mon visage, je me nourris de vos phrases… L’amour n’est-ce pas les mots et le silence – et le silence est ma part… Et quelle importance, si je ne parle pas ? Mes mots ne sont pas vie : ils parodient l’existence… Toujours je respire, simplement, comme une émotion. Et je me tais… Je contemple…
- Et comment pourrais-je ajouter quelque chose au monde. Ecrire et parler, c’est créer. Alors je me tais.- Pourtant, ils existent – mais je me refuse à exister en eux. Parfois, la nuit, ils imposent en moi leur puissance. Forts et oppressants, ils me rongent… et me laissent morte d’inanition au matin. Je les laisse à leur sort, je les éparpille en sons, en gémissements. Que je pleure ou que je cris, cela n’a aucune importance : je n’existe pas en eux… C’est ainsi que je les trompe : jamais ils ne me trahissent, ne dévoilent ce que je possède, ce que je suis. Vous parler est déjà trop…
J’ai pleuré sur vos genoux, dans vos bras, vous vous êtes perdu dans mes cheveux, ce jour là… Oui, nous nous aimions.
***
Comment séparer deux chairs éprises ? Comment frustrer la destiné du bonheur, pervertir son chemin vers mon droit légitime sur vous. La simplicité d’aimer m’a été enlevé, ce fut justice de séparer ce qui me revenait de droit.
Avez-vous jamais su quelle douleur était la mienne ? Avez-vous jamais consentit à écouter mon cœur ?
A force de temps, ma voix est devenue frauduleuse, rien ne s’échappe de sa prison. Je suis devenue trop frustrée d’amour pour aimer. J’ai trop attendu, tout simplement, pour espérer le vivre jamais. Je n’avais plus ce courage, le courage d’avoir ces gestes attentionnés, le courage de me révéler, d’aimer et d’attendre.
***
Oh ! Matthieu, j’ai si souvent parlé au vent…
La pluie commençait, discrète, par quelques gouttes pudiques, et finissait averse… je parlais… doucement, je basculais en prière, à genoux, si près de vous. Oh ! Matthieu ! il pleuvait si fort que les gouttes formaient autour de moi des rideaux de solitude. Je marchais au bord de l’eau, si proche que je failli me noyer, si proche que mes yeux se sont perdus à vous attendre… Vous étiez à mes côtés, les yeux vierges d’espoir, accueillants… avec sur moi ce reste de dignité… Enfin lavée de mes propres lâchetés… de mes propres fêlures… je parlais. Je vous parlais, à vous, à la pluie, aux éléments, à ma solitude… J’ai tant récité les prières incomplètes… Je fus comédienne, libertine, belle… amoureuse… Mais je restreins mon existence. Et pourtant, j’osais me découvrir… Presque complète, j’osais vous répondre… Seule, j’osais vous parler… de nous… … Seule, je vous confessais mon amour.
***
Que vous ai-je aimé plus, vous, qui vous lassez de mon amour… encore plus… Oh ! mon cœur, mon ami, mon amant… Vous regarder emplit mon âme d’un bonheur inaccessible… d’amour… du respect de notre amour… Oh ! pourquoi ne suis-je pas libre de mon orgueil… à vous ouvrir mon cœur… ma vérité… mon bonheur… Que n’ai-je pas exprimé mon bonheur de nos instants fragiles… Suis-je si lâche de ne pas savoir vous aimer… vous répondre, vous prendre, et vous donner… ?
Oh ! mon cœur, mon ami, mon amant… Vous écouter me donne le souffle d’exister, plus loin… au-delà de mes peurs, et de moi-même… Je vous aime… J’ose, je vous aime… Je vous aime… Simplement belle dans vos yeux, je vous aime… Heureuse à votre regard, je vous aime… Au-delà de mes incertitudes, je vous aime… Dans ma prière, je t’aime… Je t’aime Matthieu… Je t’aime…
Au lit de ton sommeil, je t’aime
Mes paupières détachées, je t’aime
Ma joie et mon envie, je t’aime
Quand nos nuits élèvent nos mains, touchent l’instant de nos retrouvailles, de notre découverte… je t’aime
Je t’aime goûter mes mains, et ton regard… rassure ma vie… Prends mon rêve, prends-moi… Donnes-moi à croire en toi,
Donnes-moi ce courage de nous aimer…
Oui… le courage d’aimer, tout doucement, simple et amoureuse… intime… avait disparu…
***
Jamais je n’ai mentis. Jamais, je n’ai promis les incertitudes de l’amour, le mensonge des toujours. Pourtant, mon oreille voyeuse grava dans mon cœur vos mirages.
Enlacés, emmitouflés dans l’hiver pâle, protégés par les cyprès, dans un labyrinthe de verdure éternel, vous avez promis. Elle, rieuse et sérieuse, réclama la fidélité, la vérité.
***
- Promets-moi… promets-moi la fidélité, la fidélité de tes yeux, de ton corps et de tes caresses, entières… et de tes baisers… »
- Je te le promets…
- Promets-moi de t’oublier toi-même, d’oublier les femmes… et les formes des femmes : d’être à moi, dans ma peau, dans mes seins, de n’exister que dans mes reins, de ne faire qu’un avec mes yeux, avec mes silences et avec tes mots…
- Tout cela je te le donne et bien plus encore…
- Promets-moi encore… Promets-moi ton âme, ton corps, tes pensées, ta force… Tout cela et plus encore : l’avenir, sans aucunes miettes pour quiconque… Respectes-moi. Matthieu, tient la promesse de tes yeux.
Elle effleura un baiser, un doigt sur vos lèvres
- Que peux-tu me promettre que tu ne m'aies déjà donné ?
- Promets-moi d’être heureuse, de veiller sur notre amour, d’être la vigilance de notre amour. Promets-moi l’indicible de tes silences et d’emprisonner mes yeux de ta beauté, toujours… Promets-moi tes souvenirs aussi… bien plus encore, promets-moi un enfant qui te ressemble, une petite fille qui te ressemble… rousse, fine et intelligente, joyeuse et réservée, que je puisse border de notre amour tous les jours de notre vie… et embrasser tout plein partout… si belle de nous, que je pourrais la consoler de ma vie… si belle, qu’elle donnerait un sens à notre amour… Promets de tes yeux, de nous aimer plus que… que notre amour passera le temps, pleinement… et d’exister en notre amour, seulement… de me reconquérir si je me perds… plus encore que nous même… Mais nous parlons trop…
Tout à la fois tendre et charnel, hésitant, une flamme inaccessible, un résumé de votre amour, une anticipation lointaine, si long, si plein, empli de vous, vous vous êtes embrassés. Je suis morte dans ce baiser.
***
J’ai prié, moi qui ne crois pas, j’ai prié.
L’église était offerte à l’épanchement, propice à la sobriété, isolée, noyée de soleil. Digne, sans autre effusion que mes larmes, tête basse, j’ai prié, sur vous, et moi, dans notre intimité.
Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché…
Mon Père... mon Père, je le trompe... La nuit, je souffle... je m'échappe : mes mains me frôlent et mes seins s'affermissent, durs, encore si fermes. Mon Père, je me donne ce qu'il oublie, loin de lui, je frémis à mes doigts... J'envie... je veux… je veux la morsure de la jeunesse, leurs corps finis de plénitude. Et crier, oui ! crier ma tendresse : en elle griffer, éructer, sortir de mon ventre de femme ces gémissements... les gémissements d’hier… et ne plus respirer, d'extase...
- Mon Père, Bon Père, son absence de contrôle, la rugosité de sa peau... son odeur émaciée, ses gestes : je ne les supporte plus... vivre loin de son mirage... Que puis-je lui donner ? Que puis-je faire ? Je mens. Mon Père, le temps a alourdi notre amour…
Son regard même est triste. Il ne dit rien, se ferme ; sa respiration le trahit. Je sais qu'il n'a rien à prendre en moi, rien... ... d'ébouriffant. Après l'amour, il se retourne, seul, alourdi, si peu dilué... son dos m'impose le mur de nos silences : je n'existe plus. Nous parler, nous viol. Alors par... par hygiène, nous nous taisons. Et je m'écoule, en boule.
Mon Père, mes vertèbres implosent, les draps... les choses restent seules nos compagnes. Et lui souffre, souffle, et pleure, aussi, je crois. Nos voix rendent nos cœurs stridents, et je brûle mon regard, mon Père... je brûle, de moi-même. Nous n’osons plus nous parler, nous revêtir de l’autre… nous aimer, tout simplement… Que puis-je faire ? Que faire ? J’ai perdu l’espoir d’aimer.
***
Mais, à quoi bon prier puisque vous ne me regardiez déjà plus : vos yeux étaient tout en elle. Mes souvenirs, mon amour, se sont évaporés loin de votre cœur. Ce fût la pire des tortures : de ne plus exister que dans votre amitié, attentive.
Oui, mon ami, en ce jour de février, mon esprit a tremblé. En ce jour si pure... translucide, elle respirait votre amour. A l’autre, vous n’étiez plus seul, à l’autre, vous n’étiez plus libre ou abandonné : l’aura de cet cœur vous transformait, gravait dans le temps mon malheur.
Oh ! Matthieu... Oh ! mon corps... Que pouvais-je faire ? si ce n’est m’arracher à ce délire. Matthieu, l’oublie de votre amour fût pire que le poison, et mon poison fût une relique de notre amour.
***
- Ma petite fille, jamais un homme écrivant ces mots ne peut aimer deux fois. Le partage et l’amour se cultivent ensemble. Les prémices de son amour n’appartiennent qu’à moi - je vous en laisse les restes…
Ces mots lus jusqu’à la mort, ces mots déclarant votre amour, que le premier amour serait pour toujours le mien, l’unique. Après, nous ne sommes plus vierge d’aimer. Elle était bien jeune pour croire à l’absolu, elle ne pu concevoir la pensée de vous partager, même dans des souvenirs.
***
- As-tu aimé, avant moi ? Oui. Tes yeux ne mentent pas : ils ne sont plus vierges… Mais… se sont-ils perdus d’amour, ont-ils tremblé d’émotion, plus loin que moi ? Plus loin que nous même ? Je suis jalouse… J’ai honte… fragile, j’ai honte… Mais… est-elle belle ? Enfin… plus belle que moi ? Sa peau, ses seins, ses jambes, son corps : en rêves-tu encore ? As-tu oublié son amour… votre amour, et vos instants fragiles ? Es-tu encore heureux dans son sourire ? Dans tes souvenirs ? Qu’est-ce qui s’est détaché pour m’aimer, aujourd’hui ? Et m’aimer : est-ce différent ? Es-tu libre d’elle, pour m’aimer… pour la première fois ? Oui, es-tu libre de m’aimer ? De nous rendre heureux ? De me donner des enfants ? Le temps efface-t-il l’amour ? Est-il toujours ainsi, ample et intime ? Embrasser, est-ce aimer, mon amour ? Est-ce aimer ?
***
Mon amour, je rêve dans le peu de mes sommeils à cette nuit oubliée où nous nous sommes retrouvés, dans l’intimité de nos cœurs, de nos esprits, au-delà de nos propres corps, un unique instant de sincérité.
Concentré à la seule lueur d’une bougie, vous écriviez, la cheminée exhalait l’unique mouvement, l’unique instant de vie d’une pièce trop ordonnée.
Moi, je ne dors pas. Les yeux fixés sur la tenture, je suffoque légèrement, je me calme pourtant, ferme les yeux.
Je me lève, me couvre d’une faible couverture : je tremble. Sous mes pieds nus, mes pas hésitants froissent le plancher, vers vous.
Sans quelque attention de votre part, je vous entoure de mes bras, tout bas…
- Mon amour… Mon amour… aimez-moi, mon amour… maintenant… Prenez-moi… Aimez-moi… Aimez-moi comme lorsque vous m’aimiez… Donnez-moi du plaisir et le bonheur ensuite… L’amertume du corps, le sel et la moiteur du désir… Donnez-moi les caresses placées des amoureux, le baiser de votre langue sur mes seins, l’avenir et le passé… l’oublie, Matthieu, l’extase de votre amour… L’oublie, comme avant… comme lorsque vous m’aimiez…
Je glisse à vos genoux…
- Je suis fatiguée, je n’en peux plus d’espérer encore votre amour… encore d’aimer… et le temps ride notre amour en plus de notre jeunesse… J’attends… J’attends que vous m’aimiez maintenant… comme avant… comme lorsque vous m’aimiez… Je vous attends… J’attends.
Vos doigts effleurent mes cheveux ; timides, ils n’osent pas encore être émus, et se courbent pourtant, se perdent de baisers dans ma chevelure…
- Mathilde… comme je vous aime… je vous aime… et comme j’ai oublié de vous le dire… Je vous ai oublié… dans la pudeur, nous nous sommes perdus… Je suis devenu égoïste… égoïste et pudique… Je vous aime… Je vous aime… Je vous aime je vous aime… Je vous aime, Mathilde… Simplement…
***
Vouliez-vous plus que je ne pouvais donner ? Des mots… seuls quelques mots auraient-ils pu vous reconquérir ? Un amour perdu, sauvé par de simples syllabes : quelle injustice pathétique, lamentable, misérable ! Mon amour défiait ceux, tristes, que vous me réclamiez, défiait votre raison et mes belles assurances. Concédez moi le privilège de vous aimer. Ma vie n’aurait-elle pas été vaine, sans vous ?
Une simple promenade, une simple phrase refusée, délièrent-elles votre amour au point qu’il n’y eut plus de guérison ? Je fus volage sur vos sentiments, égoïste réfugiée d’une mélancolie que je croyais éthérée, sincère. Mais l’encre d’aujourd’hui ne peut effacer les mots funambules, d’hier.
***
- Croyez-vous m’avoir séduit, un jour ?
- Pardon…
- Oui, croyez-vous m’avoir abusé par vos mots doux et votre tendresse supposée ?
- C’est une étrange question qui vous ressemble.
- Répondez, je vous prie.
- Les mots et mon cœur ne font qu’un. Je ne cherche nullement à vous séduire mais à vous aimer. Mots que d’ailleurs vous ne me dites pas…
- Assez de vos longues phrases ! A dire vrai, elles sont pauvres. Votre cœur se devine à peine derrière elles ; ou alors, bien trop.
- Ne vous ai-je jamais envoûté ? N’avez-vous jamais ressentie mes caresses dans votre cœur ? Les mots sont les caresses de l’âme : ils donnent à aimer. C’est notre seul lien avec la réalité, un murmure dans notre solitude…
- C’est une extase mythique.
Vous avez prie ma main, mes doigts guidés par vos doigts sur le chemin de mes yeux, de mon nez… mes joues, le front, les lèvres et les cheveux…
- Fermez les yeux… je vous aime… votre esprit se vide, je vous aime… Je vous aime… Je vous aime… Je vous aime… Je vous aime… Mon amour… Notre amour chaque seconde à venir pense à sourire, doute et paresse… Je vous aime… Ma main s’ennuie, s’agrippe à votre regard, à votre voix qui s’esquisse, liée et déliée comme un dessin sur ma vie… à nos ébauches de rencontres, je vous aime…
Votre voix et votre vie,
Vos doutes et vos reins je vous aime
La douce extrémité de vos seins je vous aime
le bout de vos heures, le bout de vos peurs je vous aime
le temps et les rêves qui s’attendrissent à vous attendre je vous aime
Oui, à l’oreiller de notre vie je vous aime
Mon amour… imagine, rêve… rêve à la paupière détachée, où la joie et l’envie seraient ensemble drapées… où nos nuits élèvent nos mains, et touche l’instant de nos retrouvailles, de notre découverte…
Mon amour, nous nous aimons…
- Vous parlez trop. Je fatigue.
Et votre charme se rompit, un recul.
- Moi aussi : de vos silences, de vos phrases qui détruisent nos instants fragiles. Je suis fatigué de votre froideur. Je vous donne et vous ne me répondez pas. Jamais. Etes-vous vierge de tous sentiments ?
« Et ridicule, aussi. Auriez-vous oublié notre pacte, Matthieu ? Que je vous en rappelle les armes : L’amour peut-être, mais le plaisir avant tout. Nous ne sommes liés qu’ainsi. La performance, voilà notre contrat. Vous m’aimez, et je jouie. Vous négligez depuis trop longtemps nos affaires. Aujourd’hui, je m’exécute plus que je ne jouie.
- M’aimez-vous ?
- Dois-je vous répondre ? Avez-vous besoin de mots, d’un mensonge, pour exister ?
- Oui. Je suis faible et je les attends.
- Je vous les refuse pourtant, parce que vous doutez.
- Je ne peux douter ce que je ne conçois pas. Ce que je ne ressens pas.
- Vous raisonnez, trop. Vous cherchez les mots et non le cœur.
- M’aimez-vous ?
- Jamais… des mots…
- Mais rien ne s’échappe de votre cœur. Ni gestes, ni attentions : rien que du vent.
- Des mots, du vent. A peine décoiffée, nous les oublions. Prenez ce baiser comme la réponse à notre histoire…
… le long de mes jambes, de mes voiles, à mes genoux, le visage cerclé de pleurs, de mes mains…
Femme,
Vous suis-je digne ?
Nu ainsi de cœur et de pensées, fébrile ?
Vous sont-elles fidèles ?
Dites, je vous en supplie, aimer… je vous aime… une fois…
Les yeux penchés, je vous ai aimé, embrassé si tendrement que j’ai cru lors d’un instant, un instant seulement, à notre amour. Sans un mot, vous vous êtes perdu dans ma solitude. Je vous ai perdu. De ces mots refusés, je vous ai perdu.
***
Si mon sein droit se réchauffe encore aux premiers mots d’amour, le gauche meurt peu à peu de votre rupture.
Mathilde,
Notre pacte m’impose les armes d’une rupture. Le plaisir donné n’a pu infléchir votre bouche vers mon âme, et mon cœur s’est une dernière fois gelé à vos larmes, silencieuses.
« Cet amour n’est aujourd’hui qu’une larme évaporée, le dernier espoir d’entendre ces mots qui manquent à notre histoire est vain. Je me suis résolu à le quitter tout à fait, il y a bien longtemps.
« Il me semble pourtant que nous devons une dernière sollicitude à nos bras – à nos performances…
A défaut de sentiments, c’est à l’amour sans passion que nous rompons de corps.
Soit, mon ami, je me rends à votre infidélité. La liberté d’aimer que vous me réclamez, je vous la concède comme un souvenir nostalgique de moments agréables. Mais à tout prendre, ai-je eu tord de ne pas vous aimer trop, ni même d’espérer en vous une quelconque éternité ?
***
Mon ami, j’ai pansé notre amour au dialogue parallèle, à l’épilogue de notre histoire, si près de nos déchirures. Mes incertitudes, mes doutes, selon vos vœux, se sont meurtris vers cette liberté, une amitié bienveillante.
- Je suis vide depuis que vous me négligez. Je suis devenue vieille... Déjà, je m’observe vieillir... Longuement, j’ai vu sous mon visage poindre la vieillesse. Mes rides se dessinent ; elles préparent leurs chemins, s’habillent en moi. Bientôt, elles seront prêtes à m’immerger tout à fait. Elles précèdent ma perte.
- Mais ce sont ces rides à venir qui séduisent - et votre beauté malgré elles. Vous êtes belle, Marquise... belle... Mais votre cœur est clos. Votre indifférence est une muraille que je me suis épuisé à gravir. Je me suis lassé.
- Mais l’amour jamais ne se lasse.
- Qu’attendez-vous de moi ?
- Le cœur des hommes et des femmes est identique : seule l’approche diffère quelque peu. Et encore ne faut-il pas aller bien loin dans l’analyse. Nous recherchons tous, mon ami, la simple attention d’une âme considérée comme plus élevée. Le cœur cherche toujours à exister indépendamment de l’esprit - au-delà de la raison. Notre capacité à nous faire aimer est égale à notre propension à mentir. « Je t’aime », « je vous aime »... tous ces mots nous impliquent plus qu’il nous ait humainement possible de donner. Ils engagent notre mort. Et nous mentons. Nous mentons, car jamais nous ne donnerons notre vie pour une âme qu’en définitif nous remplacerons un jour ou l’autre. Et ce n’est que par orgueil que meurent les amants. Leur désir d’être déifié en martyr sanctifie, chez les faibles d’esprit, leur amour en de stériles souvenirs. Ils deviennent égoïstes d’aimer leur destin plus que leur vie... Alors, seul le plaisir reste comme vérité.
- L’amour et le plaisir ne font qu’un ; vous vous trompez à les séparer.
- Ne vous fiez pas à ce que vous croyez.
- Je crois que nous nous sommes mentis trop longtemps, vous et moi, et à nous même, pour jamais pouvoir nous aimer. Une seule nuit de sincérité, c’est bien peu… Nous avons espéré - mais nous nous sommes mentis. Et seule l’amitié nous est encore accessible, et non l’amour, presque par malentendu...
- Sans doute avez-vous raison ; je capitule devant vos pauvres arguments. Mais bien loin de mes théories protectrices... Est-ce insensé que d’espérer vous oublier ? Je n’ai pas su vous aimer, soit. Je n’ai pas su vous retenir. Mais le passé est le passé et que m’importe l’avenir...
- En quoi puis-je vous aider ?
- Pour aimer - pour tenter d’aimer à nouveaux, il me faut me libérer de vous. Etes-vous libre de mon amour, de nos souvenirs et de nos instants de bonheur, Matthieu ? Etes-vous libre de moi ?
- Oui.
- Alors je le suis également.
- N’est-ce pas trop simple ?
- N’avez-vous pas les mots, aujourd’hui, qui donnent le souffle d’aimer à nouveau ? Mais, je n’imaginais pas que vous me remplaciez si vite. A moins que vous ne m’aimiez plus longtemps avant notre rupture de corps. Vous m’honoriez alors de votre présence plus par affection que par amour. Votre lâcheté en est-elle moins haïssable ? Et pourtant, je ne la regrette pas…
- J’ai besoin de l’entendre, une fois encore… Vous ne m’aimez plus. Est-ce trop simple ?
- Mathilde, le temps érode tout en ce monde – même l’amour, même le grand amour, et nos plus belles espérances. C’est successivement que le temps nous fatigue, par de petites touches sans importance, mais en définitive, lourdes, denses. Le temps égraine l’amour comme une bigote son chapelet ; il nous impose mille secondes pour milles astuces, milles petites secondes pour détruire. Les mots refusés n’en furent que plus douloureux. Le fil des lames et le fil du temps ne font qu’un, Marquise… ne font qu’un… Détruire un amour, c’est dissoudre l’intimité de notre être. Par pudeur, vous avez fait cela en moi.
***
Mon amour, je vous sais perdu, mais cette lettre est pour moi plus une mélancolie qu’un espoir. Votre amitié me pèse pourtant – plus que tout, plus que ces murs, ma fin inéluctable, elle m’asphyxie. Je suis amoureuse, et je meurs, amoureuse… un souvenir, une image si précise, lucide d’un mensonge improbable, un prétexte pour vivre encore, loin de vous.
Mais déjà, la charrette s’avance, difficilement, élargissant la foule devenue dense – incestueuse : injuriante. Coquette jusqu’à l’absurde, le maquillage comme un voile de sainteté, je m’espère digne, hautaine, rectiligne. Ma lecture conjure le bruit des femmes haletantes. Vos restes de mots, la voix disséquée, collent à mes dents, claquent, s’envolent dans le soleil de leur obscénité. Elles crient, sans défense, pleurent sans conscience, rient de mes défaites, comme pour mieux cracher leurs lèvres trop courtes, et dissimuler leurs seins qui ne frémissent plus, si peu usés par la langue des hommes. Inviolées, leur cage est leur corps, et l’amour, l’exécution, un artifice de guillotine.
Je lis, inlassablement notre histoire.
Seule, avec pour unique trace votre voix en souvenir, je m’élève sous les quolibets vers sa potence.
***
C’est beau, la nuque d’une femme.
C’est une sensualité cachée, dissimulée aux regards des autres femmes, des hommes insensibles… C’est doux, chaleureux comme une offrande, foisonnant comme l’amour, libre et discret comme la débauche…
C’est beau la nuque d’une femme… sexe du visage, si timide, si pudique, impudique lien réservé du corps et de l’esprit, liberté de la conscience, de l’austérité, ses cheveux éparpillés, mutins, timides… des cheveux libres qui nous invitent à revenir en pluie, au désir qui s’offre, au baiser, à la caresse certaine, animale.
C’est beau la nuque d’une femme, Matthieu, quand elle tombe dans le silence, c’est la chaleur rattrapée… quand le métal délie le cou, coupe, c’est une insulte à la beauté… si belle, si cruelle que l’on crie «bis ! » comme lorsque l’on jouit.
***
Mais que suis-je morte en trophée expiatoire, tête glorieuse exhibée à la seule vengeance d’une catin… pure et belle catin… à ceux-là, qui n’oseront plus me maudire… l’insulte, l’invective est rassurante… affermit la certitude de vivre, un souffle plus loin… mais ils ne sont pas plus vivants que moi je meurs… dérisoire de lâcheté, mon sang leur appartient désormais… même l’horreur est puritaine, mon amour… j’ose, mon amour, et je meurs… ah ! si je pouvais vous écrire… encore vous écrire, mieux vous écrire, mon amour… et je meurs encore… de n’avoir su vous le dire… Je vous aime… Je vous aime…
Je ne suis pas seulement amoureuse comme d’autres courent après la vérité, non, je suis un ange affublé de sons, de ta voix, mon amour, de tes lambeaux d’amour. Pour toi, je me répand en libation, je me disperse en sacrifice de sainteté à ton amour.
Pour toi, je meurs aujourd’hui, demain.
Moi aussi, j’ai aimé... puissamment, fébrile...
Oui, je vous aime, avec ardeur et sang.
Publié par Michel le jeudi, décembre 28, 2006 2 commentaires
mercredi 27 décembre 2006
Marie
« La ligne droite est un exemple spécial et banal d’une courbe. »
Albert Einstein, Léopold Infeld – L’évolution des idées en physique
Matinée de juin : il pleut, il traverse. La circulation place de l’Opéra heurte ses pas. Elle l’attend, de l’autre coté de la rue et lui sourit, deux trois mots, il l’invite.
- … Un café ?
- Pourquoi pas.
Et elle répond à son sourire, minaude ses cheveux châtains, blonde légère. Les yeux clairs, soumis à la lumière, vive et accueillante, elle possède ce reste de charme qui pénètre comme par mégarde le cœur, libre et réservée. Femme, elle habite sa féminité plus que tout autre, désirable à saisir caresser, à embrasser, à désirer.
Quelques jours auparavant, ils n’existaient pas l’un pour l’autre, à peine une première rencontre hasardée, inutile. Une rue, un regard qui s’accroche, se reconnaît, puis qui s’attire, se teste, se fuit, espère et se rapproche enfin, résiste. Et s’abandonne. Les yeux n’engagent pas le corps, à peine le cœur. Il bat, un peu plus vite, incertain il s’achemine au hasard d’une deuxième rencontre, une courtoisie, vers le désir.
- … Café ?
Elle accepte, ils parlent. Les mots n’ont que peu d’importance : l’intonation, le souffle des regards volés où perce l’âme, un pas, un recul, la danse des incertitudes…
Elle lui semble fragile, ouverte au moindre sourire, un peu attentif, un peu désir, un peu doux. Elle ne l’écoute pas, le regarde, anticipe ses gestes. Il parle, ne pense pas, observe les rides de son visage, sincère.
Il ose, timide, elle accepte.
- … A samedi soir, donc.
L’appartement est grand, vaste, une seule pièce, bleue claire, blanche, une cuisine américaine, des charpentes, mansardes parisiennes, et derrière les paravents, un lit. Peu de meubles, trop de bibelots, un lion en cristal, un éléphant en bois, un cendrier… Tout cela l’encombre joliment. Des lithographies pendent comme une fierté. Cette pièce inspire un sentiment d’inachevé. Un tableau abstrait règne sur le désordre, des succédanés de vie, les vêtements, les livres, le maquillage, des sacs de toutes tailles, les stéréotypes de femme.
Elle sort de la salle de bain, les cheveux encore tièdes, en batailles, une épaisse serviette éponge l’entoure. Elle s’avance jusqu’à la psyché, et son drap de bain dévale le long de son corps, tombant sur le parquet ciré, il ne fait pas plus de bruit qu’une écorce d’orange sur un tapis. Un fil, une pluie fluette, des gouttes d’amertume explorent les restes de son corps. Ses petits seins se gonflent, bravaches, se tendent par ses épaules nacrées, sa blancheur s’éternise dans ses bras, ses mains, ses doigts qui tapotent son petit ventre rond de la trentaine. Les hanches fines, denses, riches, accèdent par la voie étroite de ses os, au charme, à un minuscule grain de beauté noir sur le haut de sa cuisse gauche, comme une intime séduction, à l’intérieur, caché, insoumis à la lingerie, à la pudeur, trop ultime révérence au plaisir, trop tôt.
Je vieillis, fébrilement murmura-t-elle.
« … Un jour, alors que je visitais le musée de la ville de Venise avec ses grands globes terrestres en bois ronds, ses livres anciens et ses bibliothèques interminables comme des mondes à la Borges, comme des univers en eux-mêmes, je gravis sans m’en rendre compte deux ou trois étages. Je passais ainsi d’un musée à l’autre, de la ville à la peinture, pour quelques lires supplémentaires payées par inadvertance à l’entrée.
Les salles étaient en réfection, et les tableaux se trouvaient rassemblés en désordre dans quelques pièces annexes. C’est là que je vis la plus belle des femmes, une Madone. Si belle, certes, mais une beauté paradoxale. Son visage était ovale et fin, lumineux, avec pourtant cette noirceur qui attire le cœur, le soleil et la lune s’unissant, charnelle comme une sainte, belle, purement charnel comme une catin, l’art unis dans une même dévotion à l’Homme, à la chair, au sacré… Je le vis tombé amoureux, mon amour, mon amant, mon mari, peu à peu, d’une image, d’un idéal, sans moi. C’est une chose terrible que de voir les yeux de l’autre vous abandonner, au-delà, où vous ne serez jamais… »
Il y a quelques mois déjà qu’elle a adoucit la lumière de la salle de bains. Elle se maquille, se cache dans l’espoir d’être découverte, ses yeux se renforcent, un peu de bleu, un peu de rouge, paupières, pommettes, lèvres… Pétillante, pinpante, elle s’ennuie.
Le choix d’un vêtement est toujours cornélien, il impose la discrétion et le plaisir, l’agréable pour soi, pour l’autre, que l’on connaît si peu. On veut se répandre et garder sa liberté, être désiré, être prise, et tenir à distance, donner et recevoir l’envie des yeux, tout, cela dans un même élan de reconnaissance, émouvoir, conquérir, un seul un instant de bonheur quand il la regardera. Etre belle dans les yeux, tout simplement.
Elle soupire, « soyons simple » se dit-elle.
Elle étale ses affaires sur le lit comme on se prépare à la guerre, dispose ses armes comme autant de stratégies. Réfléchie, envisage, renonce et recommence encore, quelques fois. Nue, elle s’observe se vêtir, avec précaution, religion, et délicatement, son soutien-gorge, sa culotte, sa jupe et son chemisier, son pull, ses chaussures, glissent sur elle, raclent sa peau,
Elle s’encourage, une fois de plus, à haute voix. « Tu es belle comme un cœur… » Une moue : une femme qui se complimente sans écho. Sa main glisse dans l’air, le vide, et froisse une écharpe de laine, comme çà, en passant. Ca la rassurent, la préservent de l’incertitude,.
Elle l’attend, la tête pleine des mots qu’elle aurait pu dire. Il sonne. Un regard suffit pour comprendre qu’elle lui plut.
- … un verre ?
Il accepte, mais ils ne tardent pas – « le temps est si beau… On peut se promener… Nous sommes en avance, on peut se promener, un peu… »
Ils marchent, se parlent entre les silences inexorables, banales et badines conversations, rient, et s’ennuient aussi, parfois. Ils forcent leur attention comme pour mieux croire dans leur rencontre, au soleil, à la pluie, au destin, qui peu à peu s’enlise en cette fin de journée. Les mains à l’abandon, seules, sans l’autre, ils parlent de vins, de livres et de souvenirs de vins. Cerise, framboise… d’armoiries, de vignes, de mise en abîme. Nonchalance, ils espèrent se découvrir, conforter l’espoir : il ne pleut pas, et le ciel se noie peu à peu dans les Tuileries. Un photographe, un mariage, une mariée… «C’est toujours heureux, un mariage… » dit-il, « et la mariée toujours belle … » Elle acquiesce, une remarque : « Moi aussi, j’ai été la star d’un jour, mais la pensé continue, la voix s’arrête, sans qu’il insiste, pudeur inattentive… La reine du bal, d’un jour, la plus belle des femmes, la plus heureuse des femmes, le plus beau des corps prés à se dévoiler. Candide, j’ai aimé. Heureuse, j’ai perdu. Absolue, j’ai renoncé. Moi aussi, j’ai dis oui. A tout. A la vanité d’aimer, d’être nu, à l’oubli des choses, l’oublie des corps, à l’accord des êtres, au respect dans le viol des corps… j’ai accepté en moi, l’autre, au-delà des rêves et de l’éternité, dans l’absolu, j’ai touché l’amour comme la lumière, l’espoir comme la perte… J’ai abandonné l’absolu pour le quotidien, pour l’apprentissage de la vie, où la soif s’éparpille semblable à soi, si éloigné de nous, de nos espoirs… nous, on se trompe de vie, d’amour… Je me suis trompée d’amour, et de vie. Comme si la fin des espérances était le début d’une respiration tant recherchée, il reste un peu plus loin, l’amour comme formulaire administratif, l’effacement de soi derrière le charme qui s’ennuie… Il ne me restait plus que la rupture, un acte à accomplir, comme une certitude déjà expulsée, une survie. »
« Moi aussi j’ai aimé. Le lendemain, moi aussi, j’ai pleuré. »
Il la précède ; galamment, il entre le premier. C’est un restaurant grec, sombre, intime juste ce qu’il faut. Au menu : sourires et feuilles de vigne. Plus verbe qu’adjectif, il domine le chemin. Elle se laisse guider comme en amour, ouverte à l’amour, le cœur disponible.
Elle parle, la voix enfantine, l’esprit adulte, le sentiment noble, délicat, apprêtée. Il l’écoute, examine déjà les émotions, le plaisir à venir, les lunettes allongées, discrètes, presque inexistantes, qui pourtant la cachent, le rituel des mains, qui se tordent, celui des yeux, tout emplit de sincérité théâtrale – il veut… Elle accepte. Dans la compréhension des cœurs, elle parle. Les regards seuls mènent aux prémices des choses. Au fil de la soirée leur respiration s’unit peu à peu, dans un même pétale de vie.
Enfin, ils espéraient.
La nuit de printemps tombe doucement dans le restaurant. Viennent alors les gestes plus précis, les regards plus attentifs, la confidence de l’enfance, la première souvent. Elle demande si peu. Si intime, si éloignée, c’est la première ébauche de pudeur, inconséquente.
C’est elle qui commença, un peu avant la fin du repas.
« Un jour, petite, j’ai vu le Père Noël, en juillet.
« Il faisait chaud, et le soleil avait autant de mal que moi à dormir. Il m’apparut dans l’entrebâillement des volets. Il entrait par le bacon. Il était tout rond, tout rouge. Il m’appela, doucement. Je répondis, mais il fit signe de me taire, un doigt sur les lèvres, comme çà… Chut… Chut…
« J’ai cru que c’était pour moi, une visite spéciale pour un jouet spécial, un jour rien que pour moi. Mais non, il entra simplement dans ma chambre. Même si je ne dormais pas, il s’avança lentement comme pour ne pas me réveiller. Il s’assit sur le rebord du lit, et resta là, muet, à me regarder, à me sourire, à me caresser les cheveux.
« J’avais cinq ans, et cette nuit là, j’apprit le silence. Il souriait, c’est tout. Rien de particulier, sans cadeaux, sans paroles. Peut-être était-ce le silence, mon cadeau. Je ne sais pas. Je me suis endormie, lui à mes cotés. Je n’ai jamais si bien dormi de ma vie. Je me souviens avoir fermé les yeux, et les avoir rouvert au matin. J’ai dormi comme on cligne des yeux – sans rêves, sans réfléchir, sans m’en apercevoir.
« Aujourd’hui encore, adulte, cartésienne et tout et tout, je n’imagine pas un instant que ce fut une illusion. Pour moi, c’est un souvenir d’enfance, un vrai, un précieux souvenir d’enfance, qui existe, tout simplement
« C’est pour çà que je crois au Père Noël. Seulement, je sais qu’il ne vient pas en décembre, mais en été, dans la première semaine de juillet, pour les enfants sages, pour leur apprendre le silence, à jouir du moment d’une présence… »
Echange standard, il enchaîna le sien, un peu avant le café, un amour enfantin.
« Moi, je n’ai pas vraiment de souvenirs de mon enfance. Elle est sans doute trop banale à mes yeux pour qu’elle force ma mémoire. Peut-être le souvenir d’un sentiment plus que d’un fait, une émotion plus qu’une histoire…
« Je me souviens d’une lumière d’été, un soleil d’après-midi écrasant, l’ombre sous les feuilles… Je me souviens de l’ombre sous les feuilles qui nous frôle, tremble sur notre peau… Je suis allongé dans un immense transat, ma copine de vacances dansant autour de moi, parmi les herbes brûlées. J’entends nos rires… Elle mime nos histoires de princes et de fées…
« Mes grands-parents habitaient sur la Côte d’Azur, près de la mer, dans une grande allée blanche de poussière. Leur maison était la troisième, je crois, et le chemin finissait en coude, avec une immense villa. C’est là qu’elle habitait. Je devais avoir sept ans, et je ne me rappelle ni de son nom, ni de son visage, simplement qu’elle avait les cheveux mi-longs, carré, roux, épais et frisés, avec sur le nez, les joues, des toutes petites tâches de rousseurs, et de grands yeux noirs. Elle riait, on riait, du bonheur d’être en vie, des babioles d’enfant… Elle était un peu plus âgée que moi, et ce dont je me rappelle, c’est d’avoir éprouvé plus qu’un sentiment amoureux, plus qu’une rencontre. Cet après-midi là, sous la lumière des ombres, elle était plus que belle. Elle était ma certitude.
« Elle incline encore mon corps, et si je l’oublie, parfois, son destin se fixe petit à petit dans l’espace ; dans le temps, elle se fige à jamais, inéluctable. » Mais tout cela, il ne le dit pas.
Deux sourires, deux souvenirs d’enfance qui s’entrechoquent, deux intimités qui se regardent, se défient, s’excluent.
Première soirée, avec le mariage comme évocation prudente de soi.
- Vous avez été marié ? demande-t-il, sans lourdeur, presque sans curiosité, comme pour se rattraper.
- Rien. Ou si peu. On s’est connu, on s’est plu, on s’est aimé, et séparé, aussi, quelques semaines après le divorce était prononcé.
« … On la devinait octogonale, autrefois. Mais, les ans, les bâtiments, avaient contraint la place près du pont de l’Académie, à Venise, à adopter une géométrie difficile, parfois plate, parfois fuyante. C’était comme si des carrés, des cercles, des triangles irréguliers avaient été superposés, un dessin d’enfant chassé au hasard par d’étranges architectes, avec en son centre, un puits aux barreaux rouillés, asséché, et tout autour, au-dessus, une lumière pas encore éblouissante, qui nous recouvrait, une lumière du matin, si douce… si douce que nous nous sommes disputés. Une sonate s’évaporait d’une fenêtre d’une maison. Je me suis arrêtée, simplement pour l’écouter gémir un peu plus, un peu mieux. Il fit une réflexion, plus ironique que déplaisante, je répliquais par le mépris. Bref, un mot envenimant un autre, j’ai jeté dans le Grand Canal mon alliance. Cela le cloua, moi également. On tituba, ensemble, une dernière fois. Un regard, le regard qui change… « Je vois que nous n’avons plus rien à nous dire. » Il partit le soir même ; nous ne nous sommes revus que quelque fois, pendant le divorce, devant le juge, entre deux avocats. Rien de plus. Je ne suis revenue que le surlendemain à Paris et il n’était déjà plus là. Alors, abandon d’un commun accord du domicile conjugal, j’ai décidé de partir à mon tour. Je ne sais pas s’il attendait un mot. Nous n’en avons jamais reparlé. Je n’ai rien dis, pas une excuse, pas un geste. Rien. Je crois que je me suis blessée autant que lui. Nous nous sommes séparés, chacun de l’autre côté de notre vie, irréversible, je n’avais plus envie de revenir. Lui aussi.
« Notre couple n’eut jamais d’identité, il fut inexistant - indigeste. Oui, c’est le mot : indigeste. Notre rupture, si abrupte, si définitive, fut notre unique originalité. Et puis plus rien que la solitude, et deux trois espérances. Je suis devenue une agnostique de l’amour. »
Ils marchent entre les canaux, les ruelles, les magasins, les places en enfilades, les couloirs de l’hôtel, le sable, la mort… Ils écrivent ensemble l’absence, le silence, qui les unit comme un fil tendu, ténu et lâche, qui les enchaîne, encore… La clé tourne, ils pénètrent dans la chambre : ils s’attachent aux bruits, à la forme des choses, à la matière.
La chambre sombre peu à peu dans le silence, les choses se taisent, le parquet ne crisse pas, leurs pieds ne semble plus toucher le sol de peur qu’un bruit, fut-il léger, ne rompe la séparation, et ne les force à se parler, des mots que tous deux redoutent, qu’un son, qu’une voix ne les retienne l’un à l’autre sans espoir de fuite, de liberté.
Elle regarde dehors, la nuit, les canaux l’aident, en de doux reflux inaudibles, à survivre, ils distraits son esprit de la conscience d’un amour qui meurt. Il fait sa valise, quelques affaires de week-end, délicatement, sans passion ni colère, insensible comme un péché. C’est fini, le soir les éclipse de noir. Lucide et pudique, ils n’osent allumer leur chagrin d’une larme, ou d’une lumière. Comme deux aveugles, comme deux sourds-muets, ils s’évitent, se quittent, ne s’aiment plus, même dans le dernier instant. Ce ne sont plus que deux absences qui se séparent.
Il part. Avec pour seul bruit, pour unique au revoir, la porte de la chambre d’hôtel qui se referme. Et elle, elle reste là, respirant avec quiétude, pâle, emplit d’elle-même, seule dans les canaux boueux de décembre en avril, seule, elle se retourne, s’assoit sur le lit, automate, les images de la télévision déferlent sur sa solitude qui recommence, encore, et qui dure, dure… L’amour n’est qu’une parenthèse entre nos solitudes, pensa-t-elle.
L’atmosphère se vida, d’un coup. Il parla. A peine un rictus de compréhension accompagna son commentaire. Il avorta l’intimité d’un mot, alors qu’elle n’attendait que le silence, peut-être un sourire. Ils prirent froid en eux-mêmes, dans un courant d’air, leurs mains se frôlèrent, enfin, par inadvertance, entre deux verres, elles se sont cherchées, pour s’essayer du bout des doigts, dans leur inconscience, se sont trouvées, mais aucune émotion n’a transpiré de leur peau : le bois, le mur. Rien.
Il paie, ne regarde même pas l’addition, sortent.
Ils marchent quelques pas, quelques instants dans les ruelles étroites, pleines de vie de Saint-Michel, un cinéma, des jeux et des affiches... La vie semble danser autour d’eux, fuir devant eux comme les galaxies. Mais rien ne s’enivre. Rien ne se touche.
Il conduit, jazz à Fip. Il la raccompagne, chaste séduction jusqu’à la porte, sans penser à entrer, ni même à l’effleurer. Le temps et les sentiments sont au calme, à la pudeur. Il toussote. Sans autre contact physique que leurs yeux, ils échangent des sourires, un peu crispés. Sans un geste, un sourire, ils se perdent déjà. Leurs regards ne veulent pas se quitter, pas encore, quelques secondes en plus qui ne veulent pas se séparer, partir. C’est terrible, une nuit, çà termine l’intimité, une nuit, si peu acquise que déjà elle se perd. Un geste, un soupir, il l’embrassa
Ils s’embrassèrent donc, par convention, un ultime espoir auxquels on ne croit plus, un acte perdu, un peut-être qui s’achève, sans fin.
Ils avaient concédé à leur volonté d’essayer une émotion propice au premier baiser. La journée, les promenades, le restaurant, le vin liquoreux…
Ou plus exactement, l’alchimie de leurs corps les éloignèrent l’un de l’autre, comme lorsqu’on touche un objet, une table, une chaise, un rien. Ils ne pouvaient s’aimer, leurs corps se refusaient à eux. L’intimité venait de claquer des doigts, une langue, un mot.
- Je vous appelle, dit-il, tous deux embarrassés.
La porte se referma, dernière séparation.
La porte s’est refermée. Elle redoutait cet instant où elle n’a plus d’illusion, un au revoir, un espoir, un peut-être, un petit déjeuner, un lendemain. Mais elle s’est refermée, rien de plus. Elle n’allume pas la lumière, la découverte du vide. Elle s’avance dans la pénombre, se déchausse, ses pieds frôlent à peine le bois, rituel incandescent que personne n’enfreint plus, elle se déshabille lentement, et brutalement, ses vêtements tombent, lourds d’elle-même, elle se douche, encore, elle se rince d’elle-même, se démaquille comme lorsque l’on se quitte, se couche, la couette jusqu’au menton, le regard dans le blanc du plafond, ses paupières ne clignent plus, les ombres la guettent, la peinture frémit, bouge en vagues successives qui se recouvrent l’une l’autre, se disloquent, descendent, la pénètrent, la transpercent, l’endorment. Elle ne respire plus.
La lune n’émoustille jamais les rideaux opaques de sa chambre d’enfant. Apprivoisés, le noir, les ombres, les peluches et les monstres, la rassurent quand elle ne dort pas. Un rais de lumière gicle sous la porte, quelques pas, un murmure de baiser, et la clenche qui tinte, illumine son esprit, doucement brillante comme un éclair : il est dix heures et papa s’en va.
La porte de sa chambre s’entrouvre, elle ferme les yeux, se recroqueville… sa mère s’incline, souriante d’amour, elle remonte délicatement la couette : tout va bien, maman ne voit rien. Parfois, les parents s’accaparent le bonheur de leurs enfants. Ils cassent l’équilibre du bien-être, comme çà, par tendresse, il mêle la vie de leur enfant à la leur.
La maison s’éteint peu à peu, tout se tait. La petite fille se redresse, s’adosse, les cheveux un peu en broussaille. Deux sonneries de téléphone : un chagrin, une inquiétude, la lumière qui se fige, encore. Mais rien, la vie ne change pas ainsi, brutalement. Pas quand on a cinq ans.
Ingénue et lucide, elle regarde de ses grands yeux le ciel, par delà les toiles et les vitres, elle transperce la matière.
Demain… elle ne l’anticipe plus, demain… exister dans l’irréel, s’aimer, se voir et se regarder, projeter son ombre dans la lumière d’un espoir : demain. Aucun indice de son existence, aucune marque au sol, sur le sable, même instable et fuyant : elle ne possède rien que le présent qui se dépouille : elle n’existe plus, ne respire plus qu’incidemment, par reflex, sans volonté, sans aspérité, elle se confond au vide. Après, rien ne doit survivre au corps, ni cendres ni cadavre, tout doit disparaître, l’esprit disloque le corps, et réparti à l’envie, l’enfance. Elle n’est plus immortelle. Elle n’est plus une enfant. Elle peut mourir maintenant.
Du balcon au sol, il n’y a que quelques étages d’oiseaux, quelques petits pas, un rêve d’éternité, pour ne pas avoir à souffrir, à grandir et à souffrir. Déjà, concentrer dans une seconde chute le point d’orgue d’une vie, concentrer pour toujours le doux équilibre du bonheur.
Mais l’espoir eut raison d’elle. Plus loin que tout, elle se sépara de la vie des autres ; hors de la vie des autres, seule et soliloque, elle se retourne, douillette, se laisse glisser en chien de fusil. Elle s’endort.
Elle se réveille doucement, s’étire un peu, n’allume rien, ni électricité ni radio. Rien d’extérieur à elle ne doit briser le silence. Elle se lève, il est tôt. Elle enfile un long pull en laine fine, blanc cassé. Elle marche, les jambes à l’air libre, albâtres et longues, aujourd’hui, elle se prend à sourire, comme çà, pour rien, du parquet qui craque lentement sous ses pas, du bruissement de ses jambes qui se frôlent, de sa respiration… Elle jouie de la vie qu’elle anime ainsi, si peu. Elle avait oublié que son bruit existait aussi. Le soleil rasant brille à nouveaux dans le petit matin, dans ce printemps morose qui ne finissait plus de pleuvoir. Tout se rassemble. Elle se fait un café, la tasse qui tinte, la vapeur de l’expresso qui éructe de vie, la cuillère… Elle sourit encore : un petit oiseau becte la vitre, pour elle, il semble lui dire bonjour, toc, toc, toc… La main, d’un geste banal et sincère, enroule ses cheveux, humaine et femme… simplement, femme, elle se retourne, se retrouve…
Elle s’assoit, la tasse chaude entre ses mains, de ses doigts à ses lèvres, elles aspirent par petites gorgées le jus noir, un peu sucré. Ses yeux embrassent tout son appartement. « Tout cela manque de chaleur, de lumière chaude, de Provence, d’étoffes rouges, oranges. De simplicité, aussi. »
Il n’appellerait pas, et elle espérait qu’il en soit ainsi.
Son cœur bat : elle l’entend, les choses quotidiennes se sont tues, et tout emplit de la chaleur de son café, Marie vit.
Publié par Michel le mercredi, décembre 27, 2006 0 commentaires
mardi 26 décembre 2006
Les Fleurs dans le Ciel
« Je ne suis personne, ni ne fus une épée
En guerre. Echo je suis, oubli je suis, néant. »
Jorge Luis Borges
Me voilà vieux pour la première fois. Je reconnais mon corps. Ce matin, devant la glace, le temps passa si vite que de mes ongles à peine effleurée, d'un revers de main, j'ai vieilli. Mon ventre, mon dos, le moindre de mes membres, de mes organes, de mes mouvements, existent dans la souffrance.
Je suis une métastase.
Demain, je mourais. Je le sais, car je le veux.
- Vos derniers examens ne sont pas bons…
- Combien de temps ? lui ai-je demandé.
- Un mois, peut-être deux. Ne prenez plus d'engagement, m'a-t-il répondu.
Il souriait.
Il était gentil, presque tendre. Nous oublions trop souvent les évidences.
J’ai pris le bus pour rentrer. Le taxi m’attendait. Je l’ai renvoyé.
- Ce n’est pas sérieux.
Je n’ai rien repondu, puisqu’il avait raison, j’ai simplement dis « Ah bon… ». Il n’a pas insisté.
Paris est étrange quand on le parcours ainsi : on s’arrête sur les gens, sur les lieux reconnus, sur un souvenir, on se détourne du Louvre, de la Concorde, on trourne sans cesse sur les places, on longe les Champs, les grands magasins, la vie des gens, des autres. Ils avaient l’air d’exister un peu plus aujourd’hui. Leurs visages ne se souciaient de rien de plus que d’eux-même. En bus, on ne passe pas, on croise seulement. Mais bon, c’est fini.
Ce soir, j'écris.
Comme un paradoxe, comme un testament, comme la partie d'un tout, j’écris pour un murmure, pour abhorrer les mots inutiles. Alors, une fois lue, qu'on brûle ce papier, mon unique volonté, qu'on brûle tout, jusqu'aux registres légaux me mentionnant, tout ce que contient l'Occidentale, ma maison dans la maison : la longue table, large et rectangulaire, la poussière, la bibliothèque anglaise au bois clair, débordante, multiple, et les livres, une chaise, les fauteuils anglais en cuir brut, un tabouret et mon piano, mes partitions... rien ne se justifiera plus après ma mort.
J'aimerai comme ultime discrétion, mon effacement total.
Longtemps, je n'ai pas écris, longtemps, que mes doigts se sont recroquevillés, longtemps que je n'ose plus. A vingt ans, ma vie me sembla trop longue, et, aujourd'hui, je n'ai pas plus vécu. Avant, je savais décrire mes visions, extatique, les yeux émerveillés, grands ouverts, presque hallucinés, tout rond, ma langue claquait sur mes dents, entre mes lèvres et mes dents, je chantonnais, je palpais les notes de ma bouche. Et les sons s'engouffraient dans l'air en cascade, rapides, tendus, ils respiraient ailleurs, en apnés, pour moi, vers une perfection d'âme. Le tempo, la langueur des mains... elles et moi inspirions le temps, créant le monde de la seule respiration de nos doigts. Suivait une lenteur, une réalité diminuée : mais je m'arrêta, dans un découragement paresseux.
Pourtant, j'ai, depuis ce matin, quelques notes en l'air, des fragments de paysage. Mes doigts reposent sur les touches avec pour unique volonté le poids de mon corps, pour quelques heures, mon âme et mon souffle redeviennent un seul geste. La lucidité, la pensée, l'émotion, le corps, la technique, l'oublie de la technique, le piano, les notes, les sons, la musique, l'oreille, l'autre, l'air, le temps, l'éternité... le cercle s'est à nouveau refermé.
Ce soir, je joue. Sans accords, rien que des notes seules l'une de l'autre. Mon index tape ma discordance, des ruptures de notes, comme les dernières gouttes de l'eau. J'aime ce dernier phrasé, sa collusion avec la mort et l'espérance. Ce n'est pas une mélodie, c'est l'abandon, une respiration de plus, un reste, un reliquat de dignité. Ici, les couleurs s’arrêtent à la lisière de la forêt. Le silence, le bruit, n’existent plus. Ici, tout se termine – tout se tait. L’air absorbe tout, le maintient de la vie, l’atmosphère blanc comme un mensonge, sale, piqué de sable brumeux, se termine. A la fois transparent et opaque, oppressant et ironique, il s’entrouvre sur la plaine, délicatement, une offrande. Les roches concassées en une si fine poussière, recouverte de givre pillé, ne semblent jamais finir, se séparer de l’espace, du ciel et du temps. Une immense route traverse, droite, digne, insensible, où l’on devine la courbure de la terre.
J'ai évité les rencontres. J'ai vécu en ermite des autres gens. Je n'ai pas d'ami, je n'ai pas d'enfant. Mon épouse a été tout au long de ces années mon unique dialogue. J'ai esquivé grâce à ma souffrance, les autres. Très tôt, tout jeune, j'ai eu honte de ma vie. Je ne suis digne de quiconque. Cette honte est la constante de mon existence.
J'ai cherché en la musique une justification, à retrouver l'universel et l'éternité, à refaire le chemin à l’envers. Mais chaque art impose en lui ses limites, il vise l'immatériel avec pour seul médium, la chair.
Le temps n'existe pas : le passé n'existe plus, et le futur, pas encore. Dans le présent fusionne ces deux irréalités. A mes perceptions trop myopes, cette présence m’échappa. La brique fondamentale de l'infini, la jonction de l'abstrait au concret, ce basculement de l’immatériel à la chair, cette chose, cette alchimie, je l'ai recherché comme ma chimère. Et je ne l'ai pas trouvé. J'ai échoué, trop tôt, j'ai su que j'échouerai. Trop jeune, j'ai eu honte de moi.
J’ai perdu, j’ai entr’aperçu le dessin de la musique, son aspect pictural, la sculture des ondes : abrupte, aplat, elle était un mélange de glaise et de bronze, matière, où les sons s’abandonnaient aux mensonges, puis à la vérité, puis aux mensonges, une fois encore, en cercle, à l’insouciance, les notes respiraient leur liberté, et se confondaient, pourtant, au sang, à l’ensemble, au texte, au corps, à la page, à la nécessité d’être, comme un je t’aime. Chaque inflexion, chaque croche, une respiration, un mot, une lectrice, plus loin, emportent cette même volonté. Sans doute que la vérité de l’art est l’alliage de la sincérité et de la nécessité. Cela, tout cela, change-t-il l’inconscient comme la lumière lisse la fleur ? La beauté, le mensonge d’exister un peu plus, peut-être, comme un chasseur de papillons. Composer : se penser dieu, et n’être rien.
J'ai acheté, hier, peu après, pour mon autoportrait, un appareil polaroïde. En pleine lumière, devant un miroir, j'ai appuyé sur le petit bouton. De longues heures, j'ai examiné ce résumé en noir et blanc, et pour la première fois de ma vie, je me suis reconnu. Non pas aimé, non pas détesté, le vieux monsieur présent devant moi, existait, là. J'ai le teint pâle, la barbe grise en broussaille, courtes, à même la peau, et des rides, plein de rides, des ridules, des rigoles, des entailles, mes cheveux ont disparus, et mes orbites se sont creusés au fil des années, mon visage s'est lentement amaigris. Je perçois mon évolution vers la mort. Je porte un col roulé gris anthracite, et derrière mon bureau, mes mains ouvertes reposent. J’ai creusé mon visage, j’ai fui l’angoisse des couleurs, je n’ai plus de regard.
J'ai encore rêvé d'elle, de notre fille. Elle joue à la grande personne. Ses poupées attablées, elle offre le thé. Pendant de longues minutes je la regarde, le battement de mes paupières risquent de la distraire. Elle relève la tête. Elle me sourit. Une douce plénitude m’envahit.
- Tu en veux ?
- Pourquoi pas.
Alors, je m’assois, les poupées et moi prenons le thé sous la douce férule de la maîtresse de mon rêve. Elle rit, et je l’aime.
Elle a cinq ans - cela fait soixante ans qu'elle a cinq ans. Manon n'est pas morte, non, elle ne respira jamais, hors de moi. J'ai encore rêvé d'elle, mon amour. J'ai tant lutté contre la maladie pour qu'elle vive un peu plus, mais il est temps pour nous d'apprendre à disparaître. Je n’ai plus la force de nous porter. Elle me manque, mon amour, tout au long de ma vie, elle me manqua. Ce ne fut pas un regret, non, seulement un bonheur qui a fuit.
La morphine ne me soulage plus depuis des mois, et je vis maintenant dans mes déjections. Seules, ses mains dans les miennes, sur mon ventre parfois, m'apaisent. Durant bien des nuits, elle m’agrippa à la vie. Elle dormit prés de moi, à même le sol des hôpitaux, afin de me rassurer, elle m’aima, et dans ses yeux, ses mains, ses mains si vieilles, si rêches, si absolues... ses mains... je me suis tant perdu dans leurs rides, j'ai tant pleuré en elles... Dans sa vieillesse, pour moi, pour ne jamais ajouter ses maladresses aux miennes, elle s’oublia.
Je les refuserai - ne m'en veut pas, mon amour, s'il te plaît.
Autrefois, le sol était ciré, mais aujourd’hui seuls quelques îlots de parquets subsistent entre le désordre de mes manuscrits, des crayons abandonnés et des évanescences d’encre. Au fond de la cour intérieure, en haut d’une délicate montée, le silence m’imposa l’immobile, les hivers, les automnes y bruissent encore, dehors, sans que rien ne bouge, sans que je respire, jamais. Il n’y a pas de plafond, de coupures entre le ciel et moi. Par de grandes vitres, je l’ai voulu ouverte à la lumière du quotidien. Grande, vaste, fluide, blanche, j’ai aimé cet endroit, égoïstement. Assis sur le sol, mes bras entourent mes jambes qui fléchissent, un peu, je dévisage l’air, le temps. Quelques nuages, quelques soleils, mes yeux inspectent sa peau blanchâtre, rugueuse, vide encore de lumière, ils s’arrêtent sur une aspérité, une ride, un passage, une crevasse, les brumes du changement.
Il ne se passe rien d’autre que l’attente, l’inspection de l’attente.
Peut-être verrai-je alors enfin les fleurs dans le ciel.
Publié par Michel le mardi, décembre 26, 2006 0 commentaires
vendredi 22 décembre 2006
Quelques définitions…
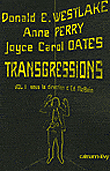
J’ai lu dans la préface qu’Ed McBain a écrit pour le recueil de novellas ci-dessus, les définitions suivants :
Pour une nouvelle : 5 000 mots,
un roman : 60 000 mots,
et une novella : entre 10 000 et 40 000 mots.
Cette ‘obsession’ des mots me rappelle bien celle d’Hemingway - à lire sa correspondance parue avec l’intégrale de ses nouvelles, chez Gallimard, collection Quatro – les auteurs étaient payés au nombre de mots, comme les feuilletonistes du XIXe siècle l’étaient à la ligne (d’où la multiplicité des dialogues à rallonge, particulièrement visible dans le Comte de Monte-Cristo, par exemple…).
Donc, la semaine prochaine je recycle, me repose – ne réfléchis plus, ne lis plus, n’écris plus… Et après, je passerai à autre chose, la semaine suivante…
Deux trois choses à noter : je n’ai jamais vraiment tenté de les faire éditer – le nombre des envois à des éditeurs doit être de quatre ou cinq tout au plus. Et encore… Beaucoup édite sur le net, dans leur blog, pour espérer conquérir un public, une expression hors système. C’est pour moi, sans doute aussi un peu vrai. Mais j’ai pour elles plus un attachement affectif qu’une véritable ambition. Les mettre sur le blog, c'est surement terminer un travail de deuil, libérer des enfants turbulents qui n'ont pas donnés pleine satisfaction...
L’année 2007 marquera la fin d’un lent processus personnel. Dont acte. Passons à autre chose.
Publié par Michel le vendredi, décembre 22, 2006 0 commentaires
jeudi 21 décembre 2006
Sideways

Pas grand chose aujourd'hui.
J'ai revu Sideways hier soir, sur Canal... J'aime ce film.
Si jamais je peux écrire ou produire, un jour, un film – et quelqu’en soit le sujet -j'aimerais atteindre la même sincérité, la même pudeur, cette justesse dans l'expression des sentiments, des idées, des rapports ambivalents...
J'aime ce film parce qu'il renvoie aussi à mes propres interrogations – ce fol espoir d’exister par les mots. De comprendre le monde pour s'oublier.
Et de boire un Cheval-Blanc, aussi.

Mais plus que tout, aboutir à trouver une apparence de justification à soi.
Et renoncer.
PS : La trève des confiseurs venant, j'ai envie de déconnecter un peu. De moins lire - juste un receuil de "novellas" d'auteur de romans noir (Transgressions - volume 1, chez Calmann-Lévy; je crois que je vais être obligé d'acheter les 3 autres...) ; et de moins écrire par petits bouts. Et peut-être le dernier Jacques Attali.
Je veux entamer 2007 à peu prés dégager de moi-même. Je vais donc mettre en post - écluser, en fait, (comme une expiation) sur ce blog les quelques nouvelles que j'ai en stock.
Aprés, je pourrais passer à autre chose.
Publié par Michel le jeudi, décembre 21, 2006 0 commentaires
mercredi 20 décembre 2006
Aujourd'hui, juste un article

Hier, j'ai trouvé sur le net sans doute l'article le plus complet, le plus synthétique : le plus intelligent qu'il m'ait été donné de lire sur le sujet.
Il a pour titre Medias traditionnels et nouveaux médias : le modèle économique va-t-il exploser ? Il a été écrit par Cristian Jegourel.
http://edgeminded.blog.lemonde.fr/
Il est long (prés de 10 pages), avec beaucoup de liens. Imprimez-les, tous : et lisez les ce midi - au lieu d'aller déjeuner, ce soir, dans le métro, dans votre lit, sous votre douche...
http://edgeminded.blog.lemonde.fr/2006/05/18/2006_05_medias_traditio/
PS : Dans le même ordre d'idée, ci-joint la lettre de l'académie des Beaux-Arts d'automne 2004, ayant pour titre Quel avenir pour le cinéma au XXIe siècle. Je vous recommande particulièrement les contributions de Gilles Jacob et de Patrick Brion.
http://www.academie-des-beaux-arts.fr/actualites/lettre/lettre38.pdf
Publié par Michel le mercredi, décembre 20, 2006 1 commentaires
mardi 19 décembre 2006
"World of Warcraft" , "Second Life", la vraie vie des mondes virtuels (C+)

Canal + diffuse jeudi soir, à 23 heures, un documentaire sur les mondes virtuels. http://www.leblogtvnews.com/article-4944990.html
A tire personnel, c'est une notion trop éloignée de mes penchants naturels - tout comme les jeux vidéos et la technologie en général... Mais, c'est phénomène important - humainement : je pense que cela dépasse le simple effet de mode.
Dés lors, la question, c'est : aprés le documentaire, à quand la fiction ? Sous quel angle ? Quelle histoire ? Comment rendre humain ce qui ne l'ai plus tout à fait ? Quels personnages ? Quelle construction pour le récit ? Quelles références ? Comment replacer tout cela dans des envies intimes, dans un décor scientifique plus général ?
Et tout cela, sans faire un "Matrix 157".
Je suis certain que quelque part, sans doute aux USA, peut-être en France, quelqu'un travail le sujet.
Mais, bon, voilà - je me lance : j'ai. Pas grand chose - juste quelques pages (4), le personnage principal, la construction du récit, l'ambition, un but, LA référence... l'introduction, le contexte d'évolution, le pitch... Bref, une base de départ.
Donc, si ça intéresse quelqu'un, ami, producteur, diffuseur, contacts divers... c'est disponible sur simple demande (avec un "s'il vous plait") pour avis et confrontation.
Publié par Michel le mardi, décembre 19, 2006 0 commentaires
lundi 18 décembre 2006
En réponse à Cédric (sur Mafiosa)

La comparaison avec les Soprano, ce n'est pas moi qui la fait, mais la productrice elle-même. (Doit y avoir son interview quelque part dans le blog…). Le parallèle posé – dont acte : prenons-là au mot. On nous parle d’un budget de 10 M d'€ : l'image est belle, les décors splendides, les acteurs déplorables. Ou la mise en scène. Ou l’écriture. Bref, ça ne marche pas. Quand aux ‘impératifs’, pourquoi pas. Mais alors, on fait avec, pas en deçà. Il est vrai que je connaissais les détails de l’histoire mais la fiction ne transcendant pas la réalité, c’est un peu ennuyeux, n’est-il pas ? Je suis d'accord sur l'ambition - elle est respectable. Et même enviable. J’avais envie. J’espérais aussi tellement en tant que spectateur.
Mais le problème n’est pas là.
Je viens de lire un article intéressant dans Télérama cette semaine. Le titre est à peu prés celui-ci : La Télévision va-t-elle tuer la diversité au cinéma ? Cet article (que je n’ai malheureusement pas retrouvé sur le net...) explique (entre autre) que les diffuseurs veulent de l’explicatif dans l’écriture – à lire surtout la citation d’un grand metteur en scène. Au-delà du factuel (les avions) et même de Mafiosa, sans doute le véritable problème est-il là.
Nous connaissons inconsciemment les codes, les rites et les méthodes. Penser qu’il faut être explicatif c’est prendre les spectateurs pour des imbéciles, c’est enfermer les auteurs, metteurs en scènes et producteurs dans des carcans plus que castrateurs : improductifs.
Avez-vous remarqué comment 24 heures joue sur notre regard ? Et même notre cerveau ? Les auteurs semblent nous dire : « regardez, vous avez trouvé dés le premier coup d’œil, le méchant ? Eh, bien, le voici, qui se révèle dans l’épisode suivant. Vous aviez raison. Mais il y a autre chose. Et ça, vous ne le savez pas… Vous ne pouvez pas le savoir ! » Le principale risque de faire cela, c’est la surenchère stérile – cf. la saison 4 – qui annihile toute véracité, toute crédulité du spectateur. Le second degré prend le pas en lui, dans sa pensée. Mais la série semble avoir résolu cela dans la saison 5. Et nous sommes scotchés. Je suis là. C’est un jeu que je perds, et j’adore ça !
Je disais précédemment que nous ne devions plus faire de distinguo entre télévision et cinéma. Mais il est à noter qu’aux Etats-Unis, le sens c’est opéré du cinéma vers la télévision – et non l’inverse. En France, le vrai risque (voir l’article de Télérama), c’est qu’encore une fois, que les décideurs comprennent tout de travers… Et n’inversent le sens et les ambitions.
Publié par Michel le lundi, décembre 18, 2006 0 commentaires
vendredi 15 décembre 2006
Quatuor
 « Pour y répondre, les majors américaines présentes tant dans l'audiovisuel que dans le cinéma ont mobilisé leurs meilleurs scénaristes, producteurs et acteurs.»
« Pour y répondre, les majors américaines présentes tant dans l'audiovisuel que dans le cinéma ont mobilisé leurs meilleurs scénaristes, producteurs et acteurs.»Enseignements rapides :
- Nous voyons le vrai tryptique audiovisuel : scénariste, producteurs, acteurs – auquel, j’ajoute (pour former un quatuor parfait), le réalisateur.
L’équilibre : au centre de la périphérie des réseaux. Penser global, agir global – trouver sa place entre le technique et l’artistique, l’innovation et la continuité… On ne fera pas l’économie d’une professionnalisation, presque d’une industrialisation de la Recherche dans le monde de l’audiovisuel en France.
Etre devant, un peu avant…
-----------------------------------
Autre chose.
-----------------------------------
Finalement, je suis présent – et même si c’est pas gagné, il convient d’être optimiste. Je suis assez soulagé. Pas tout à fait. Mais un peu quand même.
Publié par Michel le vendredi, décembre 15, 2006 0 commentaires
jeudi 14 décembre 2006
Une baisse positive…

Je mets en ligne ce soir, le post de demain – je ne serai peut-être pas présent pour le faire, alors…
J’avais fais des prévisions d’audience sur David Nolande – et comme d’habitude, je me suis planté… Foot, télé, cinéma : même combat.
http://makingblog.blogspot.com/2006/12/david-nolande-sur-france-2-ce-soir-vos.html
Mais, bon, la chute d’un mercredi sur l’autre m’inspire quand même. Elle révèle une véritable attente du public : +/- 8 millions le premier soir. Je pense que cette attente est (pour partie) insatisfaite - et je m’inclus dedans. D’où la baisse, et le report sur Julien Courbet…
Malgré tout, c’est un encouragement pour continuer à proposer plus de nouveautés dans la forme et dans le fond. La frilosité n'est plus de mise. Qui saura la vaincre empochera le jackpot. Je voudrais juste mettre cela en parallèle avec l’édito parue dans Les Echos ce jeudi…
« Avec le succès des séries américaines, Hollywood tient sa revanche sur la téléréalité. Cette vague, qui a pris son essor en Europe du Nord, avait déferlé sur les Etats-Unis au début des années 2000. Pour y répondre, les majors américaines présentes tant dans l'audiovisuel que dans le cinéma ont mobilisé leurs meilleurs scénaristes, producteurs et acteurs. »
http://www.lesechos.fr/journal20061214/lec2_entreprises_et_marches/4512590.htm
No comment.
Publié par Michel le jeudi, décembre 14, 2006 0 commentaires
Juste pour le fun
Vive la RTBF !!!!
http://www.leblogtvnews.com/article-4893429.html
Publié par Michel le jeudi, décembre 14, 2006 0 commentaires
Cher Sisyphe,

Tu m’interpellais à juste titre – cf. ci-dessous, les post du vendredi 8 décembre.
Que dire pour ma défense ? Rien de particulier si ce n’est expliciter ma pensée.
La notion de temps est à mettre en parallèle avec d’autres projets personnels (dont je parlerai ultérieurement – ou pas) ayant trait avec le sentiment profond que nous vivons une période de mutation rare. Devant les bouleversements techniques et sociologiques liés aux technologies de l’information (convergence des écrans, numérique, internet…), je ressens le besoin accru de nouveautés et d’innovation dans le développement des contenus (certes) mais surtout dans la façon de générer de nouvelles idées et de nouveaux concepts. L’analyse et l’application de ce process – la recherche d’une nouvelle façon de travailler, et de proposer... m’intéresse tout autant qu’écrire.
J’aimerai t’expliquer également comment je compte résoudre le syndrome ‘du beurre de cacahuètes’ qui me guette - comment je commence (à peine) à travailler. Tout est question d’organisation.
Laurent Fabius expliquait que Matignon nécessite une « colonne vertébrale » intellectuelle solide afin de ne pas avoir à se créer sa grille de lecture au moment même de traiter les problèmes. C’est pour solidifier constamment ‘ma colonne vertébrale intellectuelle’ que je lis autant. Lire, écouter – être en éveil. Etre éclectique.
Dans mon esprit, je classifie les idées ainsi :
- les idées en vrac – articles, envies, discussion, pistes à explorer… Elles sont pour ainsi dire jetées sur le papier ;
- celles qui donnent lieu à 'mémo', où j’énonce clairement une idée, une note de lecture détaillée, un argumentaire… Cela me permet de laisser trace, et le cas échéant d’avoir une base pour proposer (exemple : Prisme) ;
- selon l’écho obtenu (en moi-même ou par rapport à autrui), les mémos peuvent donner lieu à un concept. Ce dernier est constitué d'un contexte, pitch, synopsis, présentation des personnages, résumé des épisodes… (TV) ; et/ou développement de la mécanique d'un concept (TV) ; et/ou synopsis (cinéma) ;
- enfin, la dernière étape, c’est l’écriture d’un traitement, d’un scénario…
De fait, à partir de janvier prochain, ma semaine sera découpée en 2 phases (inspiration Google) : 4 jours au développement de concepts et/ou de scénario ; 1 jour réservé à l’écriture de mes mémos.
A ce propos, cf. le post suivant : http://affinits-eclectiques.blogspot.com/2006/09/la-naissance-dune-ide-suite.html
Voilà. Je voulais expliquer ma démarche, la rendre concrète. Je revis depuis un peu plus d’un an. J’avais besoin, d’une part, de me prouver, que ma mécanique intellectuelle existait encore, que je pouvais ; et d’autre part, j’avais besoin de matière première. Ces deux étapes franchies, je pars à la conquête du monde…
tout en sauvegardant mes oreilles...
Michel
PS : lire la chronique de Jacques Attali cette semaine dans L’Express
http://www.lexpress.fr/idees/tribunes/dossier/attali/dossier.asp
Publié par Michel le jeudi, décembre 14, 2006 2 commentaires


